Soutenue par des investissements massifs, l’industrie locale peine encore à transformer le plus grand marché de consommation d’Afrique en véritable atout de croissance.
Dans son rapport « Nigeria: Country Private Sector Diagnostic » publié en juin 2025, la Banque mondiale note que l’industrie pharmaceutique nigériane a progressé en moyenne de 9,1 % par an entre 2016 et 2023. Les ventes de médicaments ont atteint 2,03 milliards de dollars en 2023, représentant 14,6 % des dépenses de santé du pays. Mais pour l’institution de Bretton Woods, cette croissance reste fragile : la demande locale est encore trop limitée pour soutenir durablement l’expansion de la production nationale, au moment où Abuja vise 70 % de fabrication locale de produits de santé d’ici 2030.
Stimuler la demande pour soutenir les ambitions
Comme dans plusieurs autres pays d’Afrique subsaharienne, les Nigérians financent eux-mêmes la majorité de leurs dépenses de santé. Il faut dire qu’à peine 5 % de la population dispose d’une assurance santé. Le manque de couverture santé universelle limite l’achat de médicaments et donc l’incitation pour les industriels à investir dans de nouvelles capacités de production.
Pourtant, l’industrie pharmaceutique nigériane est appelée à quintupler au cours des cinq prochaines années, afin d’atteindre 10 milliards $ en 2030. L’objectif annoncé le mois dernier par l’Association des pharmaciens communautaires du Nigeria (ACPN) rejoint l’ambition du gouvernement fédéral, qui veut réduire la dépendance du pays aux médicaments importés.
« Le Nigeria compte 230 millions d’habitants, et nous ne produisons pas la majorité de nos produits de santé. Nous en importons 70 %. Comment cela peut-il être logique ? Notre objectif est d’inverser ces chiffres », soulignait le mois dernier Dr. Abdu Mukhtar, coordonnateur national de l’Initiative présidentielle destinée à débloquer la chaîne de valeur des soins de santé (PVAC).
Selon la Banque mondiale, l’atteinte de ces différents objectifs passera par un certain nombre d’actions du côté de la demande. L’une des solutions proposées est d’actualiser la liste nationale des médicaments essentiels afin de faire des médicaments qui y figurent des priorités centrales de production pour les fabricants pharmaceutiques nigérians.
Selon l’OMS, les médicaments figurant sur ce type de liste répondent aux besoins prioritaires d’une population en matière de soins de santé et « sont destinés à être disponibles à tout moment […] à des prix abordables pour les individus ». Il s’agit donc de médicaments qui sont généralement à forte demande constante, ce qui peut soutenir durablement la production locale. De plus, la Banque mondiale recommande l’utilisation de stratégies d’achats groupés au niveau local afin de réduire davantage le coût d’acquisition des médicaments de cette liste.
L’impact d’une demande plus forte sur la croissance de l’industrie pharmaceutique est d’ailleurs confirmé dans une étude publiée en juin 2025 par un chercheur de l’université Oye-Ekiti au Nigeria. Il y met en évidence un « effet positif et statistiquement significatif » entre le pourcentage de la population ayant accès aux médicaments essentiels et la contribution de l’industrie pharmaceutique à l’économie.
« Cela reflète l’importance de l’accessibilité pour stimuler la croissance industrielle et la demande sur le marché, ce qui signifie que, à mesure que plus de personnes accèdent aux médicaments nécessaires, la production locale augmente, ce qui renforce la contribution du secteur pharmaceutique au PIB », indique l’auteur Adeyemi Olayisade.
Financement et réglementation : les derniers freins
Rendre les médicaments plus accessibles ne suffira toutefois pas à transformer l’industrie pharmaceutique nigériane sans un effort parallèle sur les autres maillons du secteur. Les procédures douanières peuvent être imprévisibles, ce qui rallonge les délais de dédouanement et alourdit les coûts. Les chaînes d’approvisionnement souffrent d’un accès limité aux principes actifs, en l’absence de fournisseurs locaux fiables.
La pénurie de professionnels qualifiés freine la montée en puissance du secteur, tandis que les coupures d’électricité obligent les industriels à recourir à des sources d’énergie de substitution onéreuses, ce qui pèse sur leur compétitivité.
À cela s’ajoutent des lenteurs réglementaires et des incertitudes administratives, qui dissuadent les investissements lourds dans la production locale. Le processus d’enregistrement de nouveaux médicaments peut durer jusqu’à 390 jours, contre 210 jours en Inde ou 230 en Chine.
L’accès au financement reste également un obstacle clé, alors que plusieurs grandes compagnies pharmaceutiques ont exprimé un besoin de financement compris entre 15 et 50 millions de dollars chacune sur les cinq prochaines années, pour ajouter de nouvelles lignes de production ou moderniser les lignes existantes.



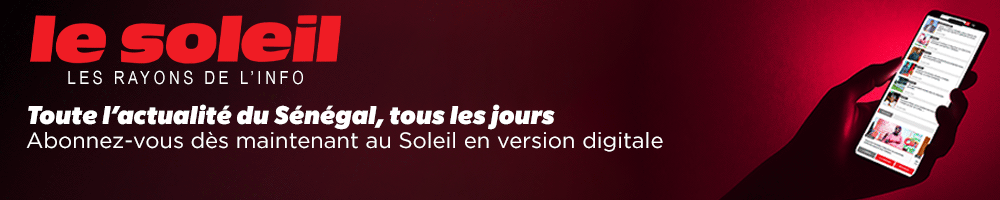


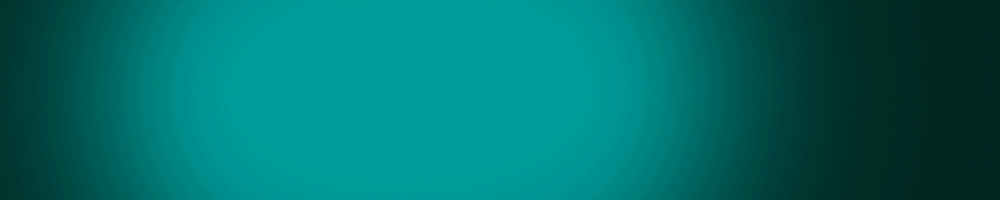
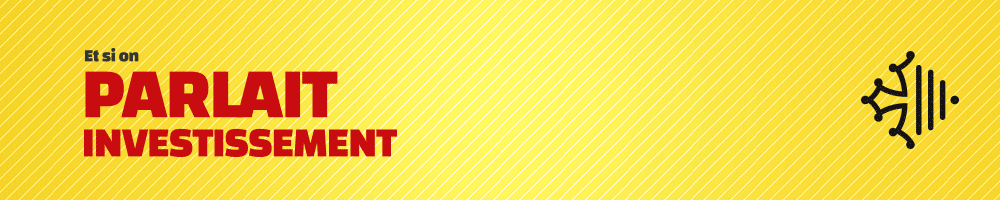

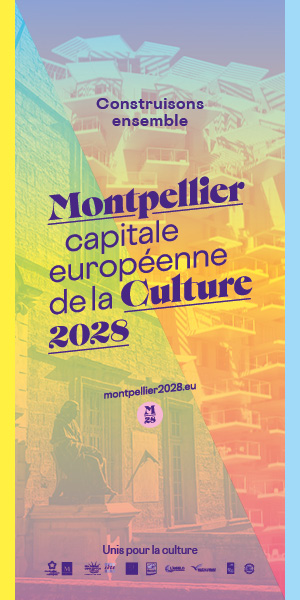
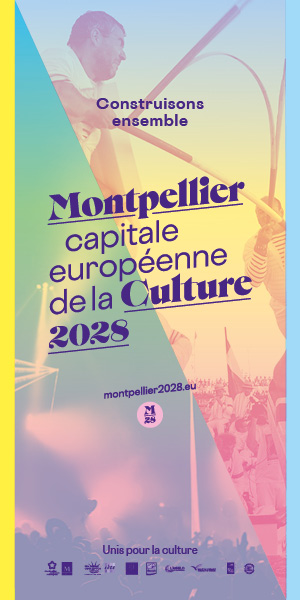


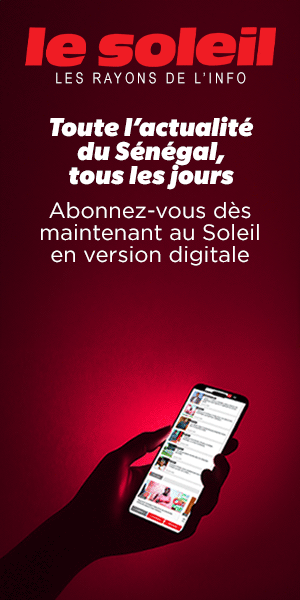


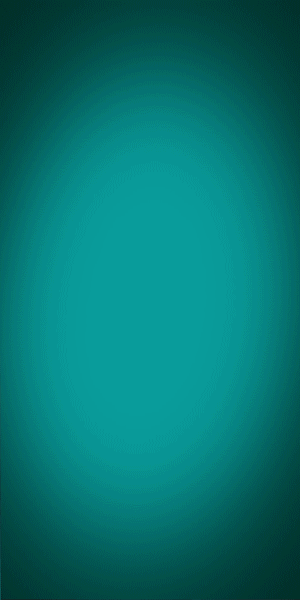




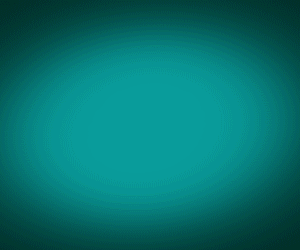






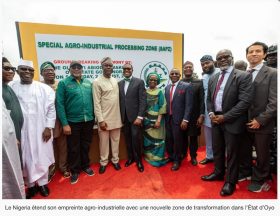


Réagissez à cet article