La région du Nil, cœur vital pour plusieurs pays d’Afrique de l’Est et du Nord, est aujourd’hui confrontée à des défis majeurs liés à la gestion de ses ressources en eau. Entre croissance démographique, changement climatique et projets d’infrastructures, les enjeux économiques se mêlent aux tensions politiques, suscitant des inquiétudes quant à la stabilité régionale.
Le Nil est la source d’eau principale pour au moins 11 pays, dont l’Égypte, le Soudan et l’Éthiopie, qui dépendent fortement de ce fleuve pour l’agriculture, l’industrie, la consommation domestique et la production d’énergie. Cette ressource, déjà sous forte pression, est confrontée à une demande croissante liée à l’augmentation rapide de la population régionale, estimée à dépasser 600 millions d’habitants d’ici 2050.
L’Égypte, signataire historique de traités sur la gestion des eaux du Nil, fait face à un stress hydrique sévère, avec un déficit annuel de l’ordre de 54 milliards de m³. Ses ressources internes sont insuffisantes, elle dépend à plus de 90% du Nil pour satisfaire ses besoins en eau. Cette situation est aggravée par la croissance démographique – la population a atteint plus de 107 millions en 2024 – et par les pertes importantes dans son réseau de distribution.
L’Éthiopie, en amont, ambitionne de satisfaire ses besoins énergétiques et agricoles par le Grand Barrage de la Renaissance (GERD), un projet hydroélectrique gigantesque qui suscite depuis des années des tensions diplomatiques avec l’Égypte et le Soudan. L’impact potentiel de ce barrage sur le débit en aval pendant les saisons sèches est source de préoccupations majeures, menaçant l’approvisionnement en eau.
Le Soudan, quant à lui, se trouve au carrefour des conflits d’intérêts, dépendant lui aussi du Nil mais particulièrement affecté par l’instabilité politique et les dégradations environnementales. La régulation conjointe des flux et la coopération renforcée deviennent des urgences pour la gestion harmonieuse des ressources.
Sur le plan économique, la sécheresse et la disponibilité limitée en eau pèsent lourdement sur l’agriculture, moteur clé des économies locales, et sur la sécurité alimentaire. Elles limitent aussi la croissance industrielle et la production d’électricité hydraulique. La crise hydrique entraîne des pertes économiques considérables et accroît la vulnérabilité des populations, notamment rurales.
Des initiatives régionales, comme le projet NCCR piloté par la Banque mondiale et l’initiative CIWA, visent à renforcer la coopération transfrontalière pour une gestion raisonnée et intégrée des ressources. Elles soutiennent la planification d’investissements résilients au changement climatique, la sécurisation des infrastructures hydrauliques et la mise en place de systèmes innovants d’information partagée.
Cependant, l’incertitude politique, les intérêts divergents et les dynamiques de rivalité autour du contrôle de l’eau freinent souvent le dialogue et augmentent le risque de conflits potentiels dans une région déjà marquée par des tensions.
La gestion des ressources hydriques dans la région du Nil est donc à la fois un défi économique vital et un enjeu géopolitique majeur. Pour garantir un avenir durable, il est crucial d’établir des cadres de coopération justes et durables, intégrant les dimensions environnementales, sociales et économiques, et de promouvoir une vision commune à long terme.
En synthèse, la sécurité hydrique dans le bassin du Nil représente un test stratégique pour la paix, la prospérité et le développement régional, où la gestion concertée de l’eau pourrait bien devenir un symbole fort d’intégration plutôt qu’une source de conflits.



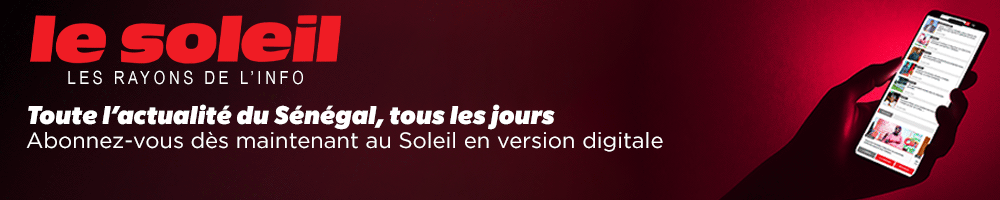


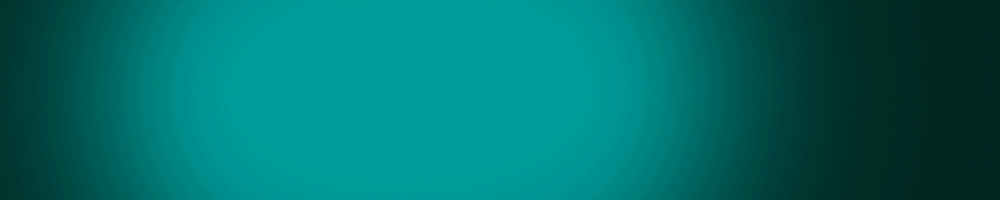
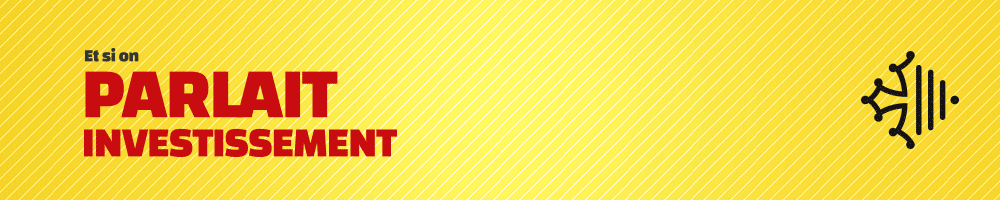

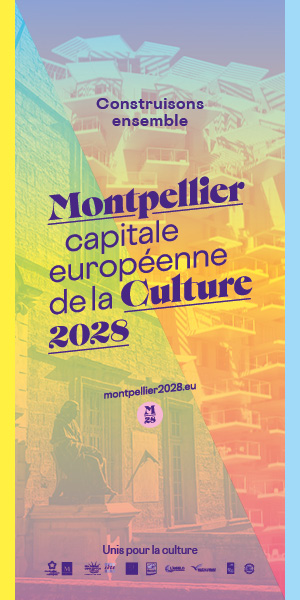
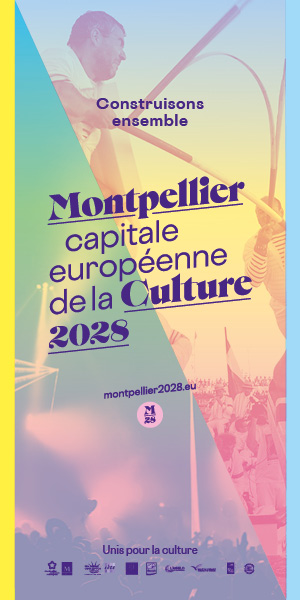


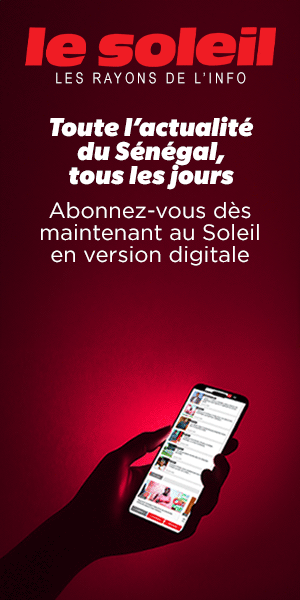


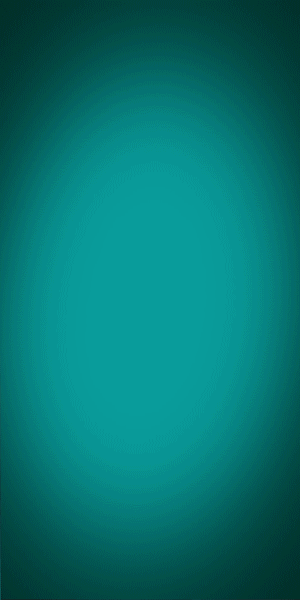




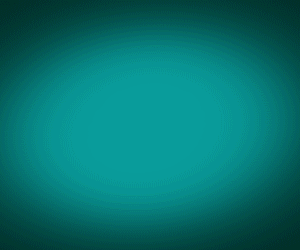

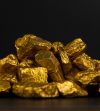







Réagissez à cet article