Alors que l’Asie centrale et du Sud ont considérablement réduit leur retard, le rythme reste trop lent dans la zone subsaharienne du continent, surtout en milieu rural. Pourtant, les progrès ailleurs montrent qu’une accélération est possible, si les politiques sont ciblées et les investissements adaptés.
Le rapport « Tracking SDG7: The Energy Progress Report 2025 » publié en juin par l’AIE, l’IRENA, l’ONU, la Banque mondiale et l’OMS montre que 92% de la population mondiale avait accès à l’électricité en 2023, contre 87% en 2010. Le nombre de personnes non connectées est ainsi tombé à 666 millions. Mais 85% de ce total se concentre désormais en Afrique subsaharienne, qui présente l’essentiel du déficit mondial.
En 2023, la région a enregistré 35 millions de nouveaux raccordements, mais dans le même temps, la population y a augmenté de 30 millions de personnes. À ce rythme, la perspective d’un accès universel d’ici 2030 s’éloigne.
S’inspirer de l’Asie centrale et du Sud, notamment dans les zones rurales
En moins de quinze ans, les zones centrale et du Sud de l’Asie sont passées d’un déficit massif à une quasi-universalité de l’accès à l’électricité en milieu rural. Le nombre de personnes sans électricité dans ces milieux est passé de 383 millions en 2010 à seulement 24,8 millions en 2023, soit une réduction de plus de 90%. Ce résultat remarquable repose en partie sur le recours stratégique aux mini-réseaux et aux solutions solaires autonomes, particulièrement adaptées aux zones isolées.
Cette dynamique s’inscrit dans une progression plus large. L’ensemble de la région a réduit son déficit global d’accès à l’électricité de 414 millions de personnes en 2010 à 27 millions en 2023, soit une baisse de 387 millions. À l’inverse, l’Afrique subsaharienne accuse un retard croissant qui s’accentue au fil des années. La région concentre désormais 85% de la population mondiale sans électricité, contre 50% en 2010.
La fracture est encore plus marquée en milieu rural. 451,1 millions de ruraux en Afrique subsaharienne restent sans accès, malgré une percée des kits solaires et mini-réseaux. Ce contraste met en lumière l’insuffisance des politiques actuelles, l’écartement géographique des populations rurales, et le sous-financement des infrastructures d’électrification.
L’Afrique subsaharienne ne manque pas de technologies ni d’idées, mais de coordination, de financements massifs et de volontarisme politique à la hauteur du défi. L’expérience asiatique prouve qu’un virage est possible, à condition d’en faire une priorité nationale et continentale.
Une tendance de décentralisation qui peut être un atout
Les auteurs du rapport soulignent que 55% des nouveaux raccordements entre 2020 et 2022 en Afrique subsaharienne ont été réalisés via des solutions hors réseau (mini-réseaux, kits solaires). Ces modèles, plus rapides et moins coûteux à déployer, ont montré leur résilience aux chocs macroéconomiques. Plus de 50 millions de produits solaires hors réseau ont été vendus en 2022 et 2023.
Mais pour accélérer la tendance, le rapport recommande de lever les blocages réglementaires, d’améliorer la qualité des données, et de développer des mécanismes de financement adaptés (financement mixte, monétisation des bénéfices environnementaux, etc.). L’électrification rurale doit redevenir une priorité politique.
Une course mondiale que l’Afrique subsaharienne ne doit pas perdre
À cinq ans de l’échéance de l’ODD7, l’écart se creuse entre les régions qui accélèrent l’accès énergétique et celles qui stagnent. L’Afrique a le potentiel, les technologies, et désormais les preuves que l’accès universel peut être atteint. Il lui manque surtout un alignement stratégique entre États, partenaires et acteurs privés pour faire de cette ambition une réalité.



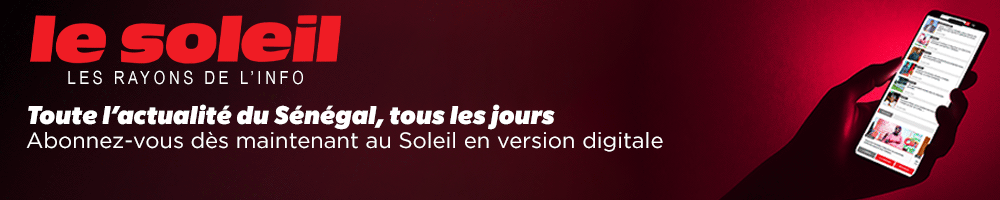


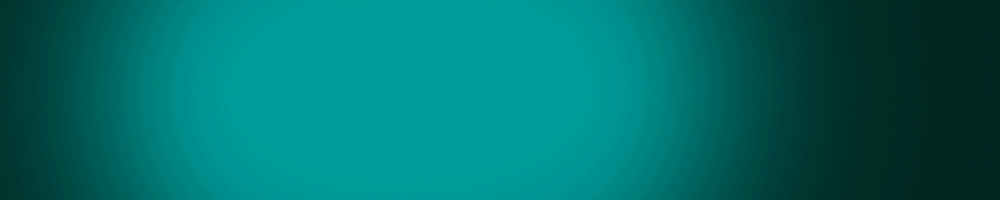
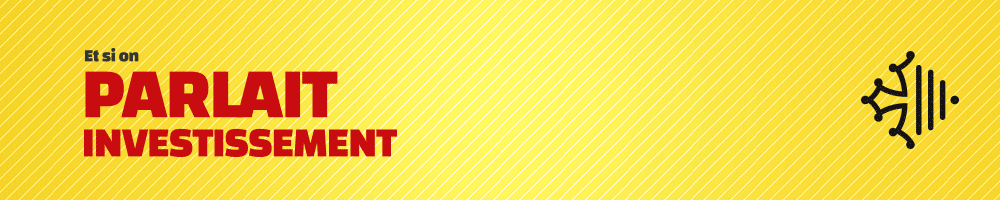

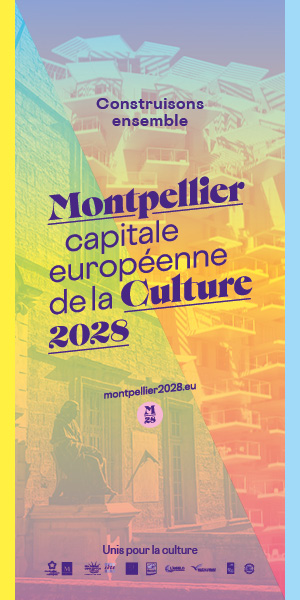
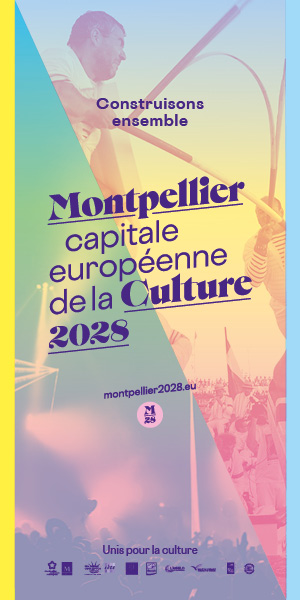


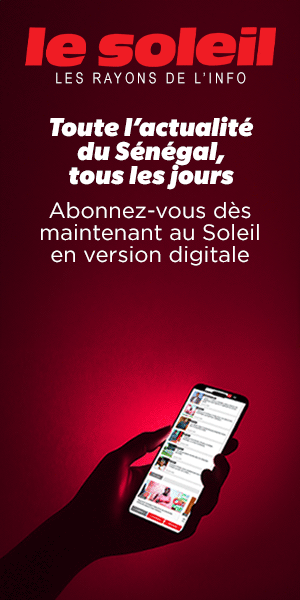


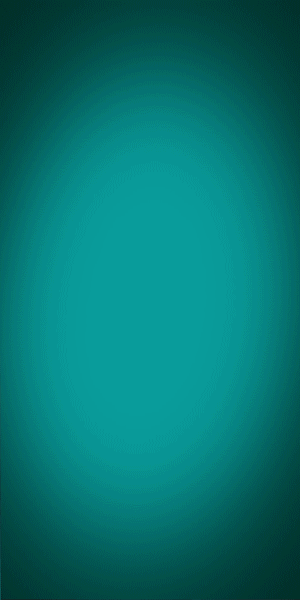




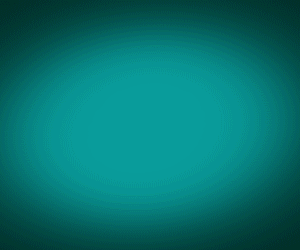


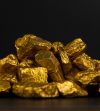



Réagissez à cet article