De plus en plus de pays africains misent sur le nucléaire pour réduire leur pauvreté énergétique sans augmenter les émissions de carbone. Le rapport souligne que la question du financement peut être résolue grâce à des modèles de financement innovants basés sur des investissements mixtes publics-privés et des accords régionaux d'achat de petits réacteurs modulaires, qui s’intègrent plus facilement aux réseaux électriques existants.
Les pays africains pourraient multiplier par dix leurs capacités nucléaires installées d’ici 2050, grâce notamment aux petits réacteurs modulaires qui ont significativement abaissé le coût du financement de l’électronucléaire et ses délais de construction, selon un rapport publié le vendredi 1er août 2025 par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).
Intitulé « Outlook for nuclear energy in Africa », le rapport rappelle que l’Afrique du Sud reste jusqu’ici le seul pays africain à produire de l’énergie nucléaire. Sa centrale de Koeberg, composée de deux réacteurs, fournit près de 2 gigawatts (GW) au réseau, et en 2024, le réacteur n° 1 a profité d’une prolongation de 20 ans de sa durée de vie. Mais plus de vingt autres pays africains souhaitent emboîter le pas au pays le plus industrialisé du continent, et plusieurs d’entre eux passent déjà de la phase de planification à celle de mise en œuvre. L’Egypte construit actuellement la centrale nucléaire d’El Dabaa d’une puissance de 4,8 gigawatts, dont la première tranche devrait être mise en service d’ici 2028.
Le Ghana, le Rwanda, le Kenya, la Namibie et le Nigeria ont pris la décision d’adopter la technologie nucléaire et travaillent avec l’AIEA pour préparer les infrastructures, mettre en place des organismes de réglementation et développer les ressources humaines nécessaires.
Le Kenya a créé en 2012 un organisme chargé de la mise en œuvre du programme d’énergie nucléaire. Ce pays d’Afrique de l’Est qui dépend des importations d’hydrocarbures a également mis en place un organe de réglementation indépendant, et vise 2038 pour son premier réacteur, avec plusieurs petits réacteurs modulaires (Small Modular Reactor/SMR) à l’étude.
Le Ghana est déjà en pourparlers avec des fournisseurs internationaux, dont l’américain NuScale Power, pour une grande centrale nucléaire et des SMR, tandis que le Nigeria a lancé un appel d’offres pour une centrale de 4000 mégawatts (MW) et signé des accords préliminaires avec plusieurs fournisseurs.
Compte tenu de ce fort intérêt pour l’énergie nucléaire dans une perspective de production stable et décarbonée de l’électricité, l’AIEA a modélisé deux scénarios relatifs aux perspectives de la filière sur le continent.
Dans un scénario optimiste (high case scenario), les capacités de production d’électricité nucléaires en Afrique devraient tripler d’ici 2030 et être multipliées par dix d’ici 2050 par rapport aux capacités totales installées de 2022. En termes d’investissement, la réalisation de ce scénario devrait nécessiter plus de 100 milliards de dollars.
Dans le scénario pessimiste (low case scenario), les capacités nucléaires installées sur le continent devraient, quant à elles doubler d’ici 2030, et quintupler d’ici 2050 comparativement aux capacités de 2022.
La promesse des petits réacteurs nucléaires modulaires

Malgré cette forte croissance prévue, l’énergie nucléaire ne devrait contribuer qu’à hauteur de 1,4% à 3,3% à la production totale d’électricité en Afrique à l’horizon 2050, contre une moyenne mondiale de 9,2% actuellement.
L’essor prévu de l’électronucléaire intervient dans un contexte où les gouvernements africains sont confrontés à un double défi : alimenter en énergie des économies où plus de 500 millions de personnes n’ont toujours pas accès à l’électricité et réduire le recours aux combustibles fossiles, qui fournissent actuellement plus de 70 % de l’énergie sur le continent.
Lorsqu’elle est intégrée dans un mix énergétique diversifié, l’énergie nucléaire offre une stabilité des prix à long terme, renforce la résilience du réseau et réduit la dépendance vis-à-vis des combustibles importés. Elle fait partie des outils d’énergie propre dont l’Afrique a besoin pour atteindre à la fois ses objectifs climatiques et stimuler sa croissance industrielle.
Sa capacité à fournir une énergie de base constante et fiable signifie que les énergies renouvelables peuvent fonctionner plus efficacement, sans être limitées par les variations météorologiques ou saisonnières.
Le rapport souligne également qu’une grande partie de la dynamique enclenchée autour de l’électronucléaire en Afrique est alimentée par l’essor croissant des petits réacteurs modulaires qui offrent une production d’électricité flexible par tranches plus petites que les centrales traditionnelles. Ces réacteurs, réalisés en usine sous forme de modules industrialisés et directement installables sur site, ont une puissance réduite, généralement comprise entre 10 et 300 mégawatts (MW). Ils permettent aussi d’abaisser significativement le poids du financement de l’électronucléaire et ses délais de construction. Les SMR sont, de ce fait, très bien adaptés aux réseaux électriques africains, petits ou fragmentés. Ils offrent également un potentiel hors réseau pour des projets industriels tels que l’exploitation minière et le dessalement de l’eau de mer.
L’AIEA indique dans ce même cadre que l’Afrique dispose déjà d’un avantage considérable dans sa course à l’énergie nucléaire, puisqu’elle contribue actuellement à hauteur de 14% de la production mondiale d’uranium. La Namibie se classe au troisième rang mondial des producteurs de ce métal radioactif utilisé comme combustible nucléaire dans les centrales pour produire de l’électricité, tandis que le Niger et l’Afrique du Sud figurent également dans le Top 10 mondial.
En Namibie, la mine d’uranium de Langer Heinrich, précédemment à l’arrêt, a été rouverte, la production devant reprendre en 2026, et de nouveaux projets sont prévus d’ici 2028.
La Tanzanie a de son côté confirmé l’existence de réserves d’uranium estimées à environ 58 500 tonnes, notamment au niveau du projet de la rivière Mkuju dans le sud du pays. Elle a déjà construit une usine de traitement de ce minerai d’une valeur de 1,2 milliard de dollars américains, en collaboration avec la Russie, sur ce même site.
Modèles de financement innovants et coopération régionale

La réalité est toutefois plus nuancée, car le rythme auquel les ambitions nucléaires de l’Afrique se concrétiseront dépendra essentiellement de la disponibilité des financements, étant donné que les projets nécessitent des montants colossaux en devises fortes et exposent les pays à un risque de surendettement. D’où la nécessité de nouer des partenariats solides avec les bailleurs de fonds et les fournisseurs de technologies nucléaires.
L’AIEA a signé récemment un accord inédit avec la Banque mondiale, amorçant la levée d’un blocage historique sur l’appui à cette filière longtemps jugée trop risquée. Avec cet accord officialisé le jeudi 26 juin 2025, la Banque mondiale rouvre la porte au soutien technique et financier au nucléaire civil pour les pays en développement, avec trois priorités : partager l’expertise, prolonger la durée de vie des réacteurs existants et accélérer le développement de petits réacteurs modulaires, présentés comme mieux adaptés aux contraintes des pays à faibles revenus. L’institution financière multilatérale signale par la même occasion aux autres prêteurs multilatéraux, notamment la Banque africaine de développement (BAD), que le nucléaire fait partie des outils de transition vers une énergie propre.
Le financement par les fournisseurs des technologies nucléaires est également en jeu. Le projet El Dabaa en Egypte, par exemple, est soutenu par d’importants prêts concessionnels accordés par la Russie à des taux d’intérêt bas et avec des délais de remboursement prolongés.
Toutefois, de nombreux pays africains sont confrontés à de faibles notations de crédit et à des ratios dette/PIB élevés. De nouveaux modèles de financement, allant des accords régionaux d’achat de SMR aux investissements mixtes publics-privés, seront donc essentiels.
L’intégration régionale pourrait par ailleurs accélérer le déploiement du nucléaire sur le continent. La coopération régionale pourrait aider les pays à partager les coûts en développant des centrales nucléaires communes, tout en maximisant les avantages infrastructurels dans plusieurs pays. Le pouvoir de négociation accru résultant de la coopération régionale peut aussi permettre aux pays africains de négocier de meilleures conditions de financement avec leurs partenaires internationaux.
Des organisations régionales, telles que le Système d’échange d’énergie électrique ouest africain (West African Power Pool) et le Pool énergétique d’Afrique de l’Est (Eastern Africa Power Pool), sont déjà là pour faciliter cette coopération. De plus, plusieurs Etats africains ont déjà une expérience dans le développement conjoint de projets énergétiques à grande échelle, comme le partage du potentiel hydroélectrique de certains bassins fluviaux, les contrats d’échange d’actifs physiques et d’énergie ou encore la construction de lignes de transport entre différents pays.



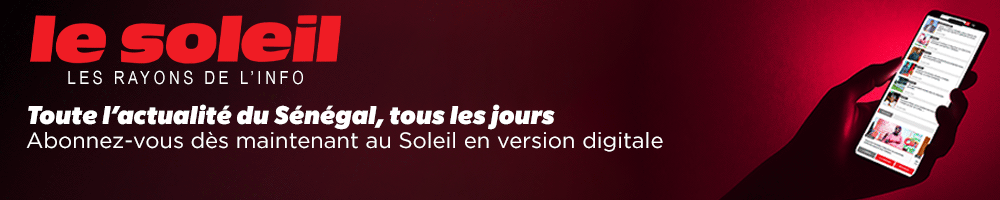


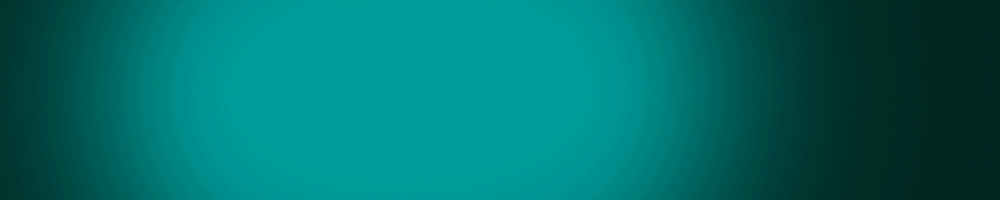
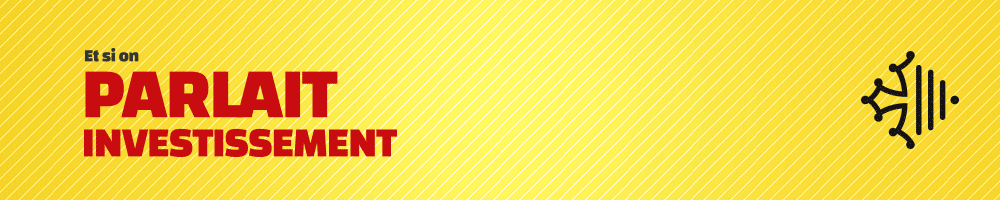

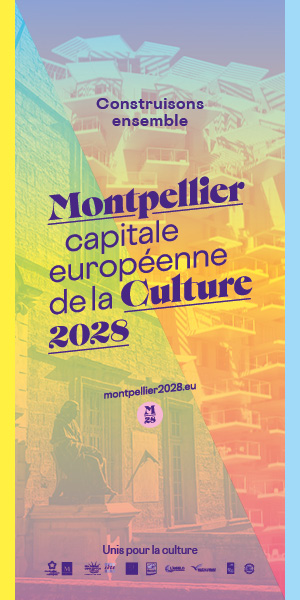
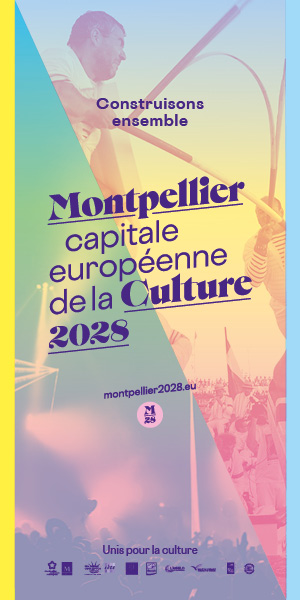


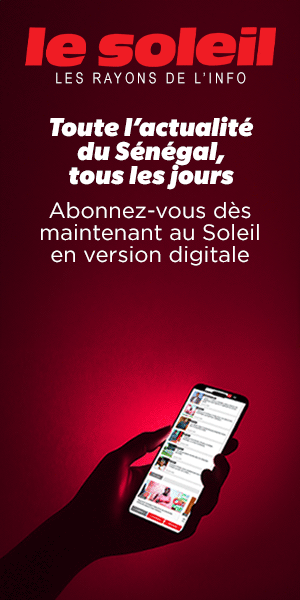


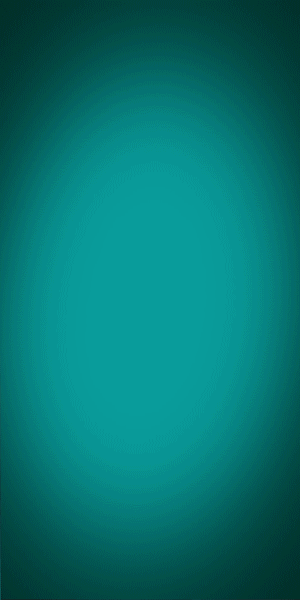




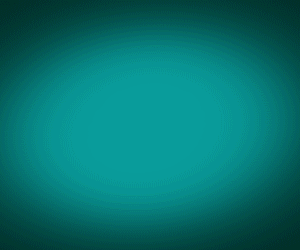









Réagissez à cet article