Cette adhésion marque une nouvelle étape dans l’ouverture de la BERD vers l’Afrique, où elle prévoit de démarrer ses opérations dès 2025. Les deux pays espèrent désormais obtenir le statut de pays bénéficiaires de la BERD pour accéder aux financements de la Banque.
Le Sénégal et le Kenya sont officiellement 4e et 5e pays d’Afrique subsaharienne actionnaires de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), portant à 79 le nombre total de ses membres. L’annonce a été faite par la banque le mercredi 23 juillet 2025.
Les deux pays ont respectivement soumis leurs demandes d’adhésion en octobre 2023 et en mars 2024. Le Conseil des gouverneurs de la banque les a approuvées en février 2024 et en mai 2024. Pour le moment, ils ne sont pas encore reconnus comme pays bénéficiaires de la banque. Cela signifie qu’ils participent à la gouvernance de la banque multilatérale basée à Londres mais ne peuvent pas encore bénéficier directement de ses financements. Leurs demandes pour devenir bénéficiaires sont en cours d’examen.
Quels enjeux pour le Kenya et le Sénégal ?
L’intégration du Kenya et du Sénégal dans l’actionnariat de la BERD marque une étape importante dans le processus d’élargissement de la banque vers l’Afrique subsaharienne, région dans laquelle elle peut désormais opérer à la suite d’un amendement de son traité fondateur. Selon Odile Renaud-Basso (photo), sa présidente, leur adhésion constitue « une étape cruciale vers le lancement des investissements de la BERD en Afrique subsaharienne ».
Elle a réaffirmé la volonté de la Banque de démarrer ses activités dans la région dès cette année 2025, en mettant l’accent sur le développement du secteur privé, la croissance économique durable et le dialogue avec les autorités nationales.
Le gouvernement kényan considère cette adhésion comme un moyen de renforcer la confiance des investisseurs et de mobiliser des fonds pour ses projets prioritaires. Le ministre des Finances, John Mbadi, a exprimé son souhait de voir la BERD accompagner des programmes économiques majeurs dans le pays.
Son homologue sénégalais, Cheikh Diba, estime que cette entrée dans le capital de la BERD permettra de stimuler la transformation économique du pays. Via ses mécanismes de financement, la banque ouvre de nouvelles perspectives aux entreprises sénégalaises, en leur facilitant l’accès à des financements alternatifs adaptés à leurs besoins.
Un amendement pour opérer au sud du Sahara
Lors de son assemblée annuelle à Samarcande, en Ouzbékistan, en 2023, le conseil des gouverneurs de la BERD a adopté un amendement à l’article 1 de l’accord fondateur. Le seuil d’acceptation des actionnaires requis pour l’entrée en vigueur de cet amendement a été atteint en avril, et l’article 1 modifié est désormais en vigueur. Cet amendement autorise la Banque à intervenir en Afrique subsaharienne et en Irak.
Dans la foulée, le Bénin, la Côte d’Ivoire et le Nigeria sont devenus les premiers pays d’Afrique subsaharienne officiellement reconnus comme pays bénéficiaires. La Banque apportera son modèle économique axé sur le secteur privé pour faciliter l’accès au financement, promouvoir les entreprises locales et favoriser une croissance durable et à long terme dans ces trois économies.
Une expansion stratégique pour la BERD
Historiquement active en Europe centrale, en Asie centrale, au pourtour méditerranéen et dans les Balkans, la BERD élargit désormais son champ d’action. L’Afrique subsaharienne devient une nouvelle zone d’intervention stratégique, avec un potentiel d’investissement dans l’énergie, l’agro-industrie, l’infrastructure et le numérique.
Fin mai 2025, elle s’est associée à l’Union européenne (UE) pour identifier et soutenir de nouvelles opportunités d’investissement au Bénin, en Côte d’Ivoire, au Ghana, au Kenya, au Nigeria et au Sénégal. L’UE a indiqué qu’elle contribuera à hauteur de 15 millions d’euros (17,6 millions de dollars) à des activités d’assistance technique pour des projets dans les secteurs de l’agroalimentaire, de l’énergie, des infrastructures, des petites entreprises, des matières premières critiques et du numérique/des télécommunications, des médias et des technologies.



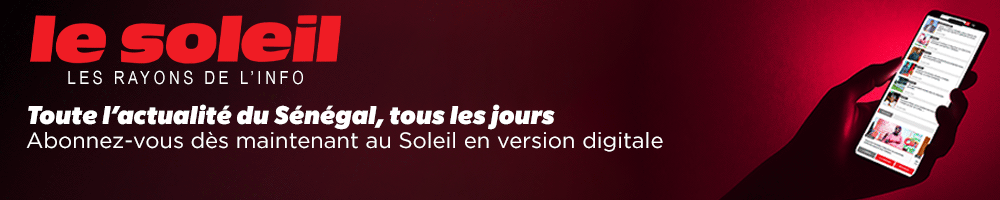


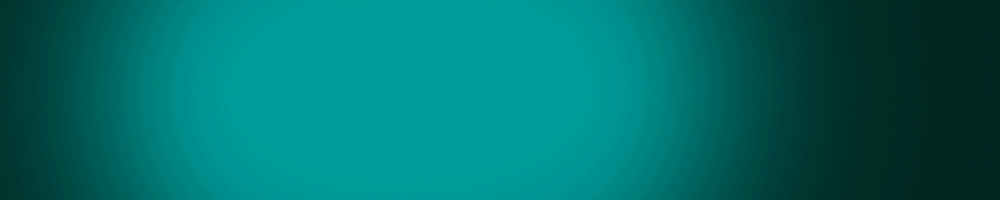
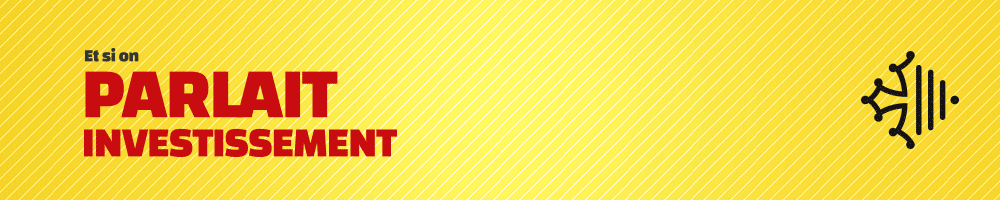

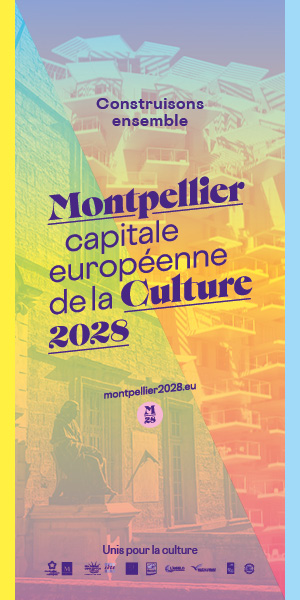
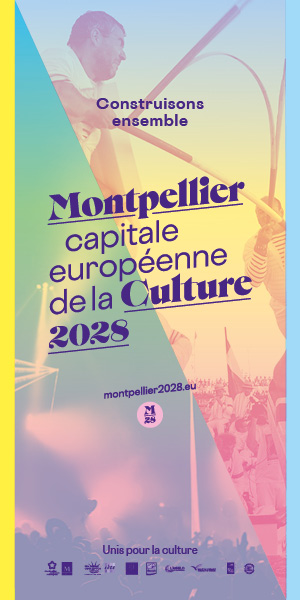


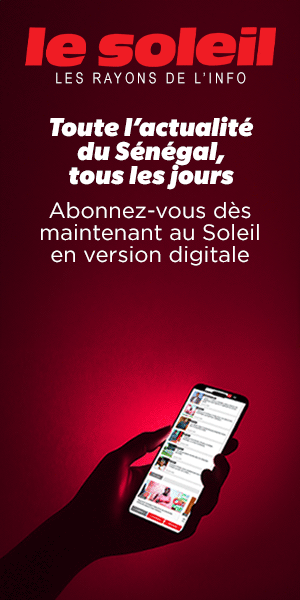


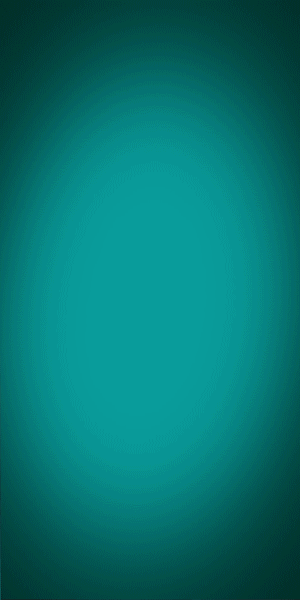




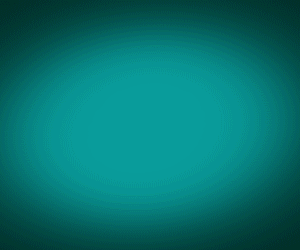






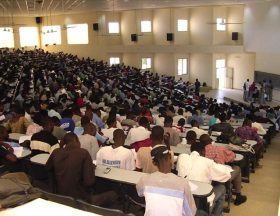


Réagissez à cet article